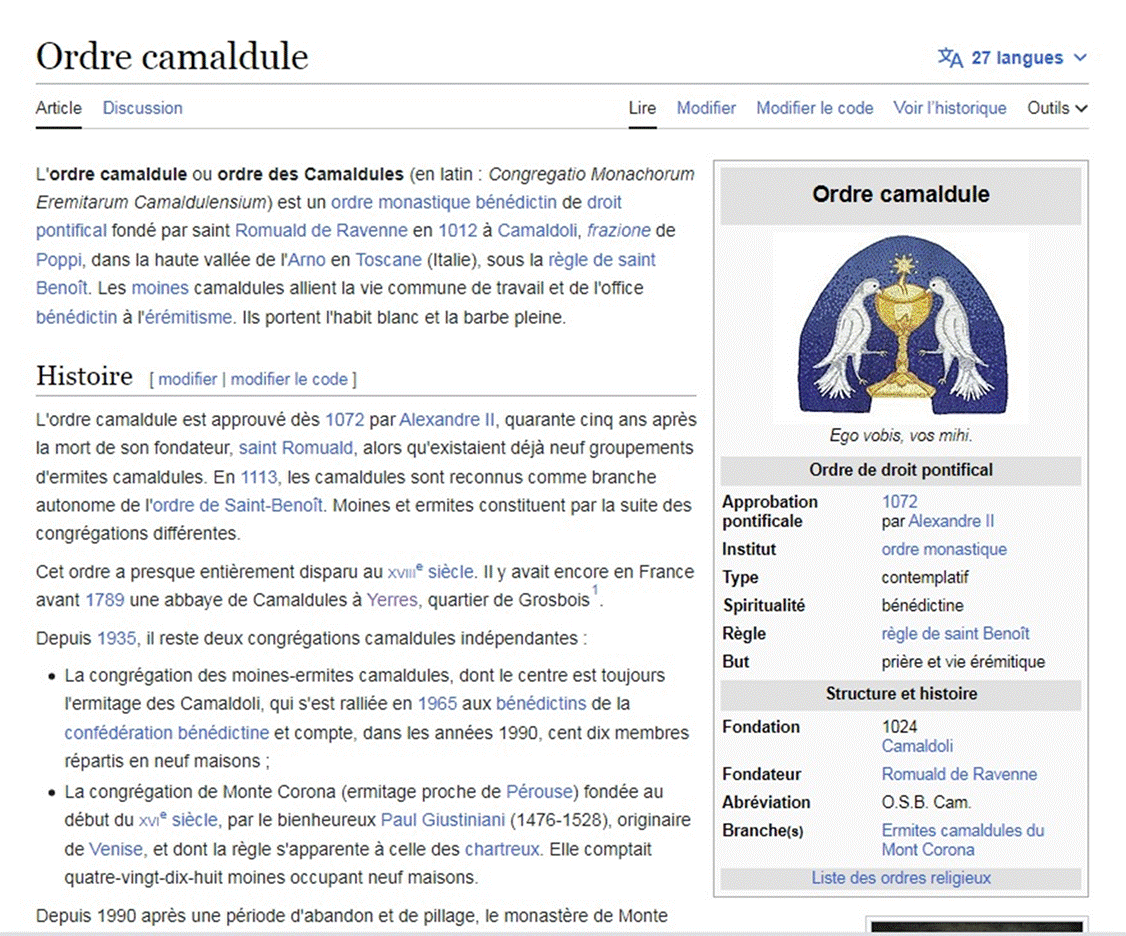| François II Rákóczi |
|
|
|
Ce nom est présent dans toutes
les villes de Hongrie. Chaque village possède une rue Rákóczi. |
|
|
| Ce grand personnage est aussi
le symbole de l’amitié franco-hongroise, mais surtout un grand homme de l’histoire de la Hongrie. |
|
|
| Sa vie a été très
mouvementée. Il a mené une guerre d’indépendance de la Hongrie contre les Habsbourg qui n’a certes pas abouti mais il a laissé son
nom dans l’histoire. Il a aussi permis à la Hongrie d’obtenir certains
droits. Il continuera la lutte même en étant en exil. |
|
|
| Cet article est un peu long
car on ne peut résumer une vie si riche en événements et en anecdotes. Je l’appelle volontairement François car il était
proche du peuple et francophile assumé. Petite histoire de ce prince haut en
couleur. |
|
|
François II Rákóczi de
Felsővadász |
|
|
François est né en 1676 à Borsi
dans la région du Zemplén (ville qui a été rattachée à la Tchécoslovaquie suite au traité de Trianon). Beaucoup de grands
hommes hongrois viennent d’ailleurs de cette région montagneuse du Nord de la
Hongrie. |
|
|
| Son père mourra peu de temps
après sa naissance. Il est le descendant des grandes familles qui avaient lutté ou conspiré contre les Habsbourg bien
avant sa naissance. Sa destinée était donc déjà toute tracée. Mais comme si
cela ne suffisait pas, sa mère se remarie avec Imre Thököly quand il a l’âge
de 6 ans. Ce Imre lancera quelques années plus tard une guerre d’indépendance
avec le soutien des Ottomans, mais il va surtout sérieusement impliquer le
jeune François dans la politique. |
|
|
| A l’époque la Hongrie était
divisé en 3 parties: la partie Ouest annexé par les Habsbourg quand les Ottomans attaquait les Hongrois, la partie Ottomane qui
était centrée sur le Danube et l’Est du pays qui était encore Hongroise,
comprenant évidemment la Transylvanie. |
|
|
| Avec une telle famille, le
jeune François se voyait mal soutenir les Habsbourg… Mais lorsque l’insurrection de son beau père échoue, il est placé sous la
tutelle de l’Empereur Léopold 1er du Saint Empire et est emmené à Vienne avec
son frère. Sa mère sera aussi à Vienne, mais internée dans un couvent. Il
sera élevé ensuite par des jésuites à Jindřichův Hradec en Tchéquie
et ira à l’université à Prague. |
|
|
| A l’âge de 18 ans il se marie
avec une princesse allemande et devient ainsi un prince du Saint Empire. Sa sœur sera mariée à un puissant général
autrichien. Il semble destiné à une vie totalement différente de celle de son
entourage et des guerres d’indépendance. |
|
|
| Cependant, en 1698 il fait la
connaissance d’un diplomate français, le Duc de Villars et rentre en contact avec Louis XIV. Il commence alors à rentrer dans
les intrigues politiques. A cette époque, l’Autriche était très puissante en
Europe. La France est l’ennemi héréditaire de l’Autriche et surtout à la
recherche d’alliés. Cette amitié est donc une aubaine, la vie de François
commence alors à basculer. |
|
|
|
|
|
Célèbre peinture de François II
Rákóczi de Felsővadász peinte par Ádám Mányoki. |
|
|
Le basculement dans la lutte |
|
|
Son amitié sulfureuse avec le
Duc de Villars est découverte et François est emprisonné. Sa vie de prince du Saint-Empire semble déjà compromise.
Vraisemblablement il ne sera pas à la Cour des Habsbourg pour prendre le thé…
Il se retrouve au cachot au Sud de Vienne. Vu le passif de sa famille, il va
être condamné à mort. Sa femme alors enceinte élabore un plan pour le sauver. |
|
|
| Il s’échappe donc de prison
pour se réfugier en Pologne (les Polonais sont les plus grands alliés des Hongrois, leur amitié date du Moyen-Age). Il reprend
par la même occasion contact avec ses alliés français, qui sont heureux de
retrouver une personne capable de faire de sérieux dommages à l’Autriche. |
|
|
| En 1701, la guerre de
Succession d’Espagne fait rage, la plupart des grands royaumes d’Europe se font la guerre (d’un côté la France, la Castille, la
Bavière et Cologne; de l’autre l’Angleterre, le Saint Empire, l’Autriche, la
Savoie, le Portugal, Aragon). C’est d’ailleurs la dernière grande guerre de
Louis XIV. Elle sera opportune pour François, car une grande partie des
troupes autrichiennes sont envoyées en Espagne. L’occasion est trop belle
pour être délaissée… |
|
|
| François se prépare alors à
une insurrection et va bien évidement en prendre la tête à l’âge de 27 ans, peu après le décès de sa mère. Nous sommes en 1703
et une des plus grandes guerres d’indépendance de la Hongrie va marquer
l’histoire. |
|
|
|
|
|
|
Les Kuruc (forces anti
Habsbourg de Hongrie, comprenant des Hongrois, des Slovaques et même des Turcs) se soulèvent à Munkács (actuellement en
Ukraine) et demandent à François de prendre la tête de ce mouvement. Il
mettra alors toute son énergie et ses ressources au profit des Kuruc. On
passe d’une insurrection à une guerre de libération nationale. En français on
appelle aussi ce mouvement la guerre des Malcontents (se référent à un Parti
Catholique pendant les guerres de religion du XVIe siècle). |
|
|
| Bien sur, François n’est pas
seul dans cette lutte. Les Polonais, fidèles alliés de toujours, envoient des troupes et des mercenaires. Louis XIV promet
d’envoyer des troupes, mais envoie plutôt des ingénieurs, des stratèges et
surtout de l’argent pour financer la guerre de libération. |
|
|
| D’un autre côté, les nobles
hongrois ne soutiennent pas vraiment cette guerre. Pour eux c’est plus une jacquerie qu’autre chose, de plus ce n’est pas la
première guerre contre les Habsbourg. Mais cette guerre obtient rapidement
des résultats et François reprend possession d’une grande partie du Royaume
de Hongrie. Les Autrichiens sont pressés de négocier ou de faire quelque
chose pour y remédier. |
|
|
| Malheureusement, la France et
la Bavière subissent une lourde défaite en 1704 à Blenheim (Bavière) contre l’Autriche et ses renforts Anglais. L’armée
française ne rentrera pas en Autriche et ne pourra soutenir militairement
François. Coup dur, car l’aide française diminue et il faut des troupes pour
garder les territoires libérés. |
|
|
| Il va mettre en place des
mesures économiques et réorganiser le pays pour pouvoir entretenir l’armée. Il va subir des défaites mais l’armée des Kuruc
sera toujours présente. Les pourparlers pour l’indépendance vont commencer
sans jamais se réaliser. Cette guerre n’a pas de gagnant. D’un côté la guerre
de libération a eu de grands résultats, de l’autre coté la Hongrie ne peut
rivaliser avec l’Autriche. Des négociations de paix ont lieu pendant des
années sans résultats, Louis XIV retire son aide car la guerre de Succession
d’Espagne ne se déroule pas comme prévue (même si l’issue sera légèrement en faveur
de du Roi de France). |
|
|
| Le combat continue jusqu’à la
bataille de Trencsén en 1708 (actuellement en Slovaquie). L’armée des Kuruc va subir une défaite décisive. Malgré les
pertes, François s’engage personnellement et fonce à cheval vers les lignes
ennemies, malheureusement il tombe du cheval et reste inconscient à terre.
Ses soldats pensent qu’il est mort et abandonnent une bataille qui est déjà
perdue malgré la supériorité numérique. Cette défaite signe la fin de la
guerre d’indépendance. |
|
|
| Militairement, les hongrois
n’ont ni gagné ni perdu. Politiquement, les objectifs ont été atteints, la Hongrie n’est pas devenue une province autrichienne
germanisée (comme par exemple la Tchéquie devenue province allemande). D’un
autre côté, même si la Hongrie n’est pas devenu
un État indépendant, cette lutte n’a pas été vaine. L’empereur du
Saint-Empire Charles VI autorisera une Constitution hongroise et une
tolérance religieuse (la Hongrie comptant de nombreux protestants). |
|
|
Inscriptions et sculpture du
cœur sous le buste de François II Rákóczi à Yerres. |
|
|
|
|
|
|
La guerre étant finie, les
Kuruc rejoignent les forces de l’Empereur Autrichien en espérant de la clémence. Cependant François n’avait aucune confiance
envers les Autrichiens et préférait s’exiler que de risquer la prison ou la
mort. Ceux qui acceptaient l’autorité des Habsbourg pouvaient garder leurs
biens et faire comme si de rien n’était. |
|
|
| Bien qu’il reçoit la clémence
des Habsbourg s’il leur jure fidélité, il est hors de question pour lui d’admettre la souveraineté autrichienne. Il quitte la
Hongrie pour la Pologne (pas vraiment une surprise). Le traité de paix
se fera donc sans lui. |
|
|
| En Pologne, on lui propose la
couronne de Pologne, mais il refusera l’offre. Après un peu plus d’un an en Pologne, il part en Angleterre. Mauvais calcul,
car étant alliée avec les Habsbourg, la Reine Anne d’Angleterre lui refuse
l’asile. Il traverse alors la Manche et va demander l’aide de Louis XIV. Il
lui rappelle l’aide des Hongrois fournie pendant la Guerre de Succession
d’Espagne qui touche d’ailleurs à sa fin. En effet, la France a repris la
main et la coalition est à bout de souffle. Le futur traité de paix est
l’ultime occasion de récupérer les territoires hongrois auprès des
Autrichiens, le Roi de France est la dernière personne qui peut aider la
cause. |
|
|
| Mais lors du traité de paix
en 1714, aucune mention n’évoque la Hongrie. François n’étant pas reconnu en tant que prince légitime même s’il était accepté
par la Cour et hôte officiel du Roi-Soleil. De plus ses enfant étaient
retenus à Vienne pour éviter que sa descendance ne poursuivent le combat. Les
Autrichiens connaissaient la famille depuis le temps… |
|
|
| Louis XIV meurt alors en 1715
et François pleure sincèrement sa mort. Il quitte Versailles et se retire pendant deux ans dans le couvent des Camaldules à
Grosbois (actuellement Yerres, Essonne). Il y écrira d’ailleurs ses mémoires
en français (“L’autobiographie d’un prince rebelle”). |
|
|
| Il
accepte ensuite de rejoindre les Ottomans (toujours en guerre contre les
Habsbourg) pour les aider contre les Autrichiens.
On ne se refait pas, surtout quand on est un Rákóczi. Il arrive donc en 1717
à Tekirdağ (ou Rodosto), sur la mer de Marmara, où il y restera
jusqu’à sa mort. |
|
|
| Dans
ses derniers vœux, il a demandé à ce que son cœur soit enterré dans le
couvent des Camaldules en France à Grosbois où il
avait résidé. François était un grand amoureux et admirateur de la France,
même si Louis XIV n’avait pu vraiment l’aider. Ses autres organes ont été
enterrés dans l’église Grecque de Rodosto et son corps dans l‘église Saint
Benoît à Galata (Istanbul) auprès de sa mère. |
|
|
| En 1905, sa dépouille a été
transférée à Kassa (actuellement Košice en Slovaquie), où il a été inhumé avec sa mère et son fils. Son mémorial à Kassa est
une réplique de sa maison à Tekirdağ. |
|
|
| Il
existe un square Rákóczi dans la ville de Yerres depuis 1937, chaque année à
lieu la célébration de l’amitié
Franco-hongroise avec la présence de Mr l’Ambassadeur de Hongrie en
France. Le buste visible sur la photo en dessous à été ajouté en 2010. |
|
|
|
|
|
|
| http://www.yerres-nostalgie.com/img/Camaldules/PrieureCamaldules.html |
|
|
|
|
|
| https://www.pologne.travel/fr/musees/couvent-des-camaldules-a-rytwiany |
|
|
|
|
|
| https://www.pologne.travel/fr/patrimoine/bieniszew-couvent-des-camaldules |
|
|
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_camaldule |
|
|
|
|
|
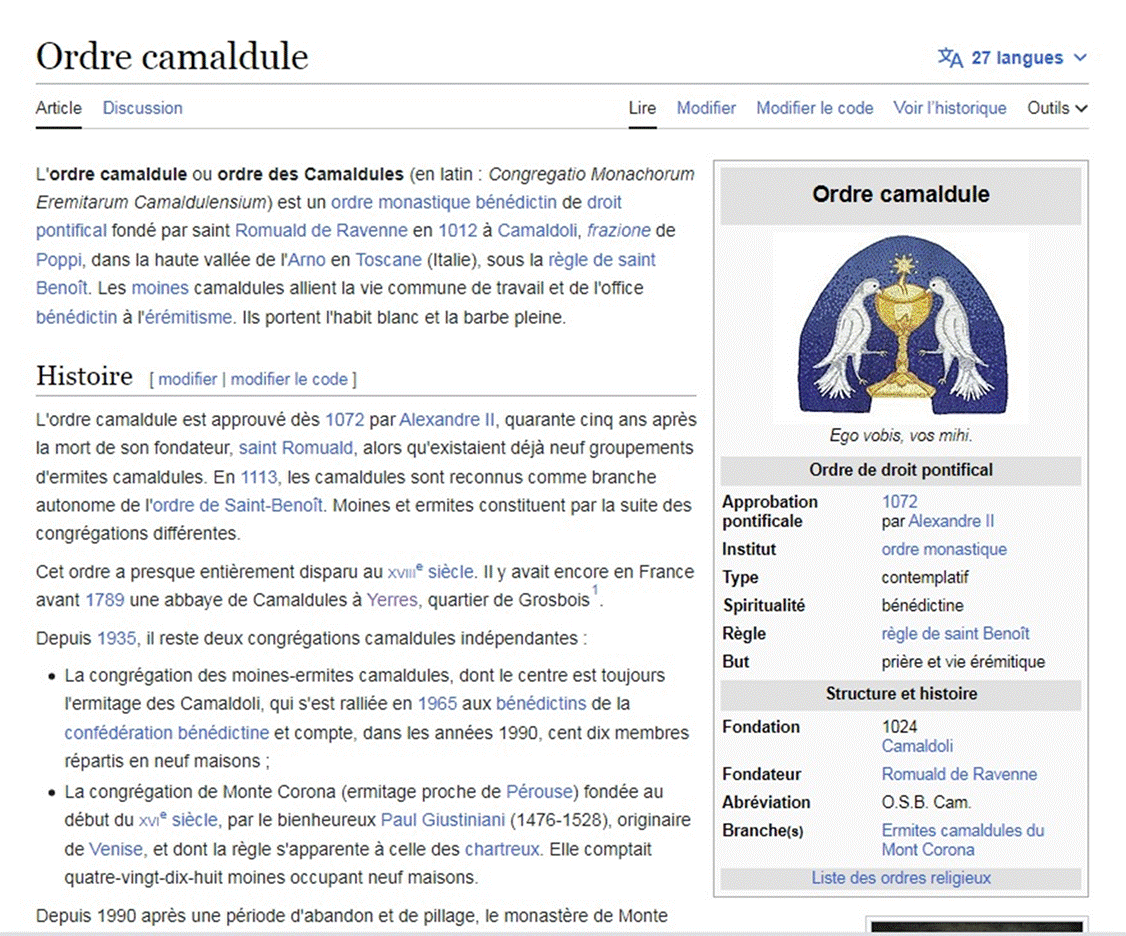
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Membres d'un ordre
religieux qui eut pour origine la fondation d'un ermitage à Camaldoli, dans
la haute vallée de l'Arno, en Toscane, vers 1023,
et qui constitue une des plus durables réalisations, avec la Chartreuse et
Grandmont, du puissant courant érémitique dont les manifestations furent
nombreuses au XIe et au XIIe siècle. |
|
|
|
|
|
| Originaire de
Ravenne, le fondateur des Camaldules, saint Romuald (mort en 1027), moine depuis 973 ou 974, avait déjà derrière
lui une longue expérience de vie érémitique avec plusieurs compagnons,
notamment Benoît de Bénévent et Bruno de Querfurt. Son ermitage de Camaldoli se développa par
essaimage ; neuf groupements d'ermites existaient déjà, en 1072, lorsque
le pape Alexandre II, par quelques privilèges, donna consistance à la
congrégation naissante ; celle-ci obtint sa pleine autonomie, sous la
règle de saint Benoît, en 1123. |
|
|
|
|
|
| Le premier
coutumier ne fut rédigé qu'après la mort de Romuald, par le bienheureux
Rodolphe (mort en 1089). Assez rapidement
d'ailleurs, des divergences se manifestèrent parmi les disciples sur la
manière d'ajuster institutionnellement érémitisme et cénobitisme, solitude et
vie commune. Cela explique, pour une part, la formation au cours des siècles
de plusieurs congrégations camaldules indépendantes les unes des autres.
Depuis 1935, elles se ramènent à deux : la congrégation des
moines-ermites camaldules, dont le centre est toujours l'ermitage de
Camaldoli, qui s'est ralliée aux Bénédictins confédérés et compte dans les années 1990 cent dix
membres répartis en neuf maisons, et la congrégation de Monte Corona
(ermitage proche de Pérouse), fondée au début du XVIe siècle
par un humaniste vénitien, le bienheureux Paul Justiniani (1476-1528), qui a une règle s'apparentant à
celles des Chartreux et compte quatre-vingt-dix-huit moines occupant neuf
maisons. |
|
|
|
|
|
| La vie des
cénobites camaldules s'ordonne selon la règle de saint Benoît ; celle
des solitaires s'apparente à celle des Chartreux.
Quelques camaldules ont laissé un nom dans l'histoire littéraire ou
scientifique : l'humaniste Ambroise Traversari (mort en 1439), un des
plus notables théologiens latins au concile de Florence ; l'éditeur du
Tasse, Boniface Collina (1689-1770) ; le mathématicien Guido Grandi
(1671-1742). Le pape Grégoire XVI (1831-1846) était aussi un moine
camaldule. |
|
|
| FONTE AVELLANA ABBAYE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Écrit par André DUVAL |
|
|
|
|
|
| 131 mots |
|
|
|
L'abbaye
italienne Sainte-Croix de Fonte Avellana (aux confins des Marches et de
l'Ombrie, dans l'ancien diocèse de Gubbio) fut
fondée vers l'an mille, comme simple ermitage soumis à la règle de saint
Benoît, par le bienheureux Ludolphe (mort en 1047). S'étant joint aux ermites
vers 1040, saint ... |
|
|
|
|
|
| ROMUALD saint (950 env.-1027) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Écrit par Jacques DUBOIS |
|
|
|
|
|
| 170 mots |
|
|
|
Appartenant à
la famille des ducs de Ravenne, Romuald est, durant trois ans, moine à
Sant'Apollinare in Classe, puis ermite dans la
lagune de Venise. En 978, il accompagne le doge Orseolo, qui va prendre
l'habit monastique à Saint-Michel-de-Cuxa dans le Roussillon. Il réside un
peu en ce monastère,...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Le hameau des Camaldules,
connu aussi sous l'appellation de Val-Jésus, tire son nom de la congrégation
monastique pour laquelle il fut fondé. En effet, il était à l’origine un
ermitage, créé par Vital de Saint Pol (1580-1639), seigneur de Peuchaud,
après ceux de Notre-Dame de Grâce et de Vassalieu. |
|
|
| |
|
|
| Aujourd’hui situé sur les
berges de la Loire, il bénéficiait autrefois de terres assez fertiles,
désormais recouvertes par le lac de Grangent, et d’une situation très isolée
qui offrait le calme et le silence allant de pair avec la vie des ermites. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Les Camaldules,
disciples de Saint-Romuald |
|
|
| |
|
|
| Qui étaient les
Camaldules ? Cet ordre, fondé au Xe siècle par Saint-Romuald, est
originaire du monastère de Camaldoli en Toscane. Les moines portaient l’habit
blanc et la barbe, et vivaient en ermites dans leur propre cellule, mais
partageaient également une vie commune (on parle alors de moines cénobites).
Ainsi, ils partageaient les temps de prière et les repas, lors desquels on
mangeait notamment du saumon pêché dans le fleuve à proximité – poisson jugé
vulgaire au XVIe siècle. On ne sait pas exactement comment cet ordre est
arrivé jusqu’aux gorges de la Loire pour s’y installer ; il semble
néanmoins que leur développement dans la région date du début du XVIIe
siècle, d'abord sous l'impulsion de François de Nérestang, seigneur de
Saint-Victor qui fait venir les Camaldules à Grangent, puis favorisé par
l’élan religieux de Vital de Saint Pol. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Une fondation qui
s'inscrit dans un fort développement de l'érémistisme sur le territoire |
|
|
| |
|
|
| Vital de Saint-Pol a en effet
fondé de très nombreux ermitages dans les environs de Vassalieu, où il est
né. Cet élan mystique s’explique par le fait qu’un événement personnel
important, vraisemblablement la survie à un accident ou à une maladie,
l’aurait conduit à complètement changer de vie. Il aurait reçu une protection
de la Vierge, pour laquelle il va faire bâtir Notre-Dame-de-Grâce en
remerciement. |
|
|
| |
|
|
| Ainsi, il incite au
développement religieux dans la région en créant de nombreux ermitages et
centres de prière. Si Notre-Dame-de-Grâce apparaît comme sa réalisation
principale, il a aussi fondé quatre autres ermitages à proximité directe
(trois dans le hameau de Notre-Dame-de-Grâce et un à Vassalieu). Il fait
venir à Notre-Dame-de-Grâce en 1610 le Père Ximénès et son compagnon, qui se
trouvaient alors à l’ermitage de Grangent. Ceux-ci étaient de l’ordre des
Camaldules, et ils résidèrent à Notre-Dame-de-Grâce jusqu’à ce que l’ermitage
devienne la résidence de l’ordre des oratoriens en 1620 : Vital de
Saint Pol décide alors de fonder un nouvel ermitage au Val-Jésus afin d’y
installer les Camaldules, qui s’étaient entre-temps réinstallés à Grangent.
Il fait construire à leur intention en 1628 l’église qui subsiste
aujourd’hui, avec un campanile de style italien. L’édifice est par ailleurs
entouré de bâtiments destinés à héberger les ermites, et l’ensemble
permettait d’assurer le service de la chapelle Saint-Roch, bâtie elle aussi
par Vital de Saint Pol pour conjurer l’épidémie de peste qui sévissait alors
dans la province, et qui devint un lieu de pèlerinage relativement important
au XVIIe siècle. |

|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Le Val-Jésus connut un
incendie au XVIIIe siècle, et seule l’église conserve son état d’origine.
L’ermitage restera occupé par les Camaldules jusqu’à la Révolution, durant
laquelle le dernier d’entre eux, Dom Jérome, prit le maquis avant d’être
capturé et exécuté en 1793. Les biens furent par la suite revendus. L’église
fut désaffectée en 1871, et les bâtiments étaient occupés par un fermier.
Signalés comme étant en ruines dans les années 30, ils furent par la suite
restaurés et remis en valeur. Racheté par EDF lors de la construction du
barrage de Grangent, le hameau eut différents propriétaires pour finalement
être racheté par des particuliers en 2012. Semblable à un « village
miniature » avec son clocher dominant les maisons environnantes, il
borde aujourd’hui le lac de Grangent et participe à son charme paysager |
|
|
| https://www.smagl.com/Hameau-des-Camaldules-article-45-2.html |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Religieux,
religieuse de l'ordre du même nom. Le camaldule
ressent des picotements de volupté à chacun des coups dont il se déchire le
corps (Flaubert, La 1reÉducation sentimentale,1845, p. 242): |
|
|
| Le bandeau fut attaché : le front
altier de Lélia fut à jamais enseveli. « Reçois ceci comme un joug, chanta
l'abbesse d'une voix sèche et cassée, et ceci comme un suaire »,
ajouta-t-elle en l'enveloppant du voile. La camaldule disparut alors sous un drap mortuaire. G. Sand, Lélia,1839, p. 455. |
|
|
|
Prononc. et
Orth. : [kamaldyl]. Ds Ac. 1835 et 1878. Étymol. et Hist. 1694 (Corneille, s.v. Camaldoli [...] Nous
n'avons en France qu'un Couvent de Camaldules ou de Camaldolites, qui est auprès de Gros-bois). Du
topon. Camaldoli (lat. Campus Malduli d'apr. Du
Cange t. 2, p. 38a et DEI), lieu de Toscane situé près
d'Arezzo où cet ordre fut fondé par St Romuald au début du xies., de
là il s'étendit d'abord en Italie puis en France, au xviies. (Théol. cath., 1425). Fréq. abs. littér. : 51. Bbg. Quem. 2es. t. 2 1971, p. 11.
|
|
|
|
|
|
| https://chambles.fr/fr/rb/947715/lermitage-du-val-jesus-les-camaldules |
|
|
| En 1628, Vital
de Saint Paul fait ériger une petite église "Val-Jésus" dans une
combe près du fleuve Loire et du ruisselet de la Garde, pour y faire héberger
les Ermites de l'ordre des "Camaldules". |
|
|
| Ces mêmes
ermittes qui étaient partis de Notre-Dame de Grâce et s'étaient réinstallés
temporairement à Grangent. |
|
|
|
|
|
| "Val-Jésus"
viendrait d’une légende qui évoque ici la venue du Christ en personne. |
|
|
|
|
|
| Vital de Saint
Paul fut obligé de créer des routes supplémentaires pour accéder au lieu,
pour la construction de l'église. |
|
|
| La
construction de l'église pris fin seulement après l'installation des
dépendances prévues pour recevoir la dizaine d'orphelins dont Vital de Saint
Paul voulait y faire élever. |
|
|
|
|
|
| A l’état de
ruines dans les années 30, cette « miniature de petit village », avec son
église et les cellules des ermites, a été remarquablement restaurée.
Approcher ces lieux (privés), c’est aussi avoir une pensée pour Dom Jérôme,
dernier des ermites du Val-Jésus qui prit le maquis durant plusieurs années,
avant de succomber sur l’échafaud en 1793. |
|
|
|
|
|
|